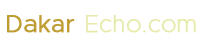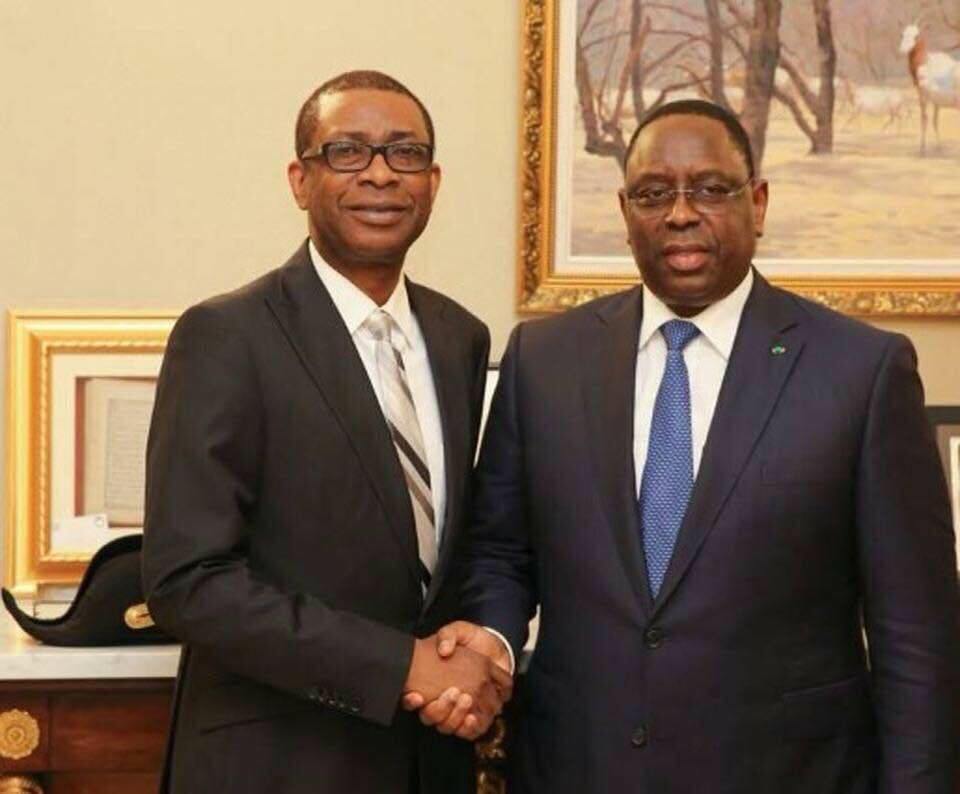Attaqués le 11 septembre 2001 par Al-Qaida, les États-Unis, et le monde avec eux, ont plongé dans une guerre contre le terrorisme qui domine depuis 20 ans les relations internationales.
Un coup de tonnerre dans un ciel qui paraissait si bleu. Le 11 septembre 2001, des attentats inenvisageables jusque-là frappaient une Amérique qui se croyait intouchable après avoir remporté la Guerre froide et faisaient voler en éclats l’illusion d’un avenir apaisé.
Les États-Unis, et le monde avec eux, plongeaient alors dans une guerre contre le terrorisme qui dominera pendant vingt ans les relations internationales, bouleversant durablement les équilibres du Moyen-Orient et masquant la résurgence de la Russie comme rival stratégique et l’émergence de la Chine comme nouvel adversaire principal.
«Aujourd’hui, on arrive à la fin d’un cycle stratégique et se referme une parenthèse où le jihadisme international était le seul ennemi identifié», dit Elie Tenenbaum, coauteur d’un livre consacré à cette «Guerre de vingt ans». Selon ce chercheur de l’Institut français des relations internationales, «la compétition stratégique entre grandes puissances est à nouveau le paradigme international», avec «l’émergence d’autres enjeux qui relativisent la menace terroriste». À commencer par une confrontation au parfum de nouvelle guerre froide entre Washington et Pékin.
La boucle est bouclée?
Pour montrer que la boucle est enfin bouclée, Joe Biden voulait que ce 20e anniversaire coïncide, de manière symbolique, avec le retrait total des forces américaines d’Afghanistan – où elles étaient intervenues au lendemain des attentats contre les Tours jumelles et le Pentagone afin de pourchasser Al-Qaida, qui les avait perpétrés, et de chasser du pouvoir les talibans, qui avaient offert un sanctuaire au réseau jihadiste.
Mais le symbole s’est retourné contre le président des États-Unis: à la veille du 11 septembre 2021, les talibans sont à nouveau maîtres de Kaboul, grâce à une victoire fulgurante contre l’armée afghane que Washington se vantait d’avoir formée, financée et équipée.
Si «la boucle semble bel et bien bouclée», c’est malheureusement car cette partie du monde risque à nouveau d’accueillir «des extrémistes très violents», grince Mark Green, élu républicain au moment des attentats et aujourd’hui président de l’institut de recherche Wilson Center. Cet ex-patron de l’aide américaine au développement fait partie de ceux qui pensent qu’il aurait été raisonnable de laisser en Afghanistan les 2500 soldats américains qui s’y trouvaient encore en début d’année, pour préserver les acquis comme les droits des femmes.
«Police d’assurance»
Pour d’autres raisons, strictement antiterroristes, John Bolton, ex-ambassadeur américain à l’ONU, s’emporte contre les présidents successifs des États-Unis. Les Démocrates Barack Obama et Joe Biden, mais aussi le Républicain Donald Trump dont il a été l’éphémère conseiller pour la sécurité nationale, se sont tous montrés trop pressés à ses yeux de se désengager pour plaire à une opinion lassée par les «guerres sans fin» de l’Amérique.
«Vingt ans, c’est une goutte d’eau dans l’océan!», tance, avec le sens de la provocation qui le caractérise, ce souverainiste sourcilleux qui défend depuis des années l’interventionnisme américain. «Ils n’ont pas expliqué pourquoi c’est mieux de se défendre contre la menace terroriste en Afghanistan plutôt que dans les rues et le ciel américains», affirme-t-il.
Selon lui, la présence en Afghanistan était «une police d’assurance contre un nouvel 11-Septembre, et cela a marché». Alors que le retour des talibans risque d’offrir au jihadisme de nouveaux sanctuaires, prévient-il. Au contraire, Donald Trump, qui a le premier sonné le retrait, puis Joe Biden, mais aussi une grande partie de la classe politique américaine, ont fait le pari qu’une renaissance d’un régime islamiste à Kaboul ne serait pas une menace vitale pour les États-Unis – et que rester représentait un coût politique plus élevé que partir.
Sentiment de puissance
Le brusque retour en arrière afghan ravive en tout cas le débat sur l’héritage controversé de ces conflits lancés par les Américains à des milliers de kilomètres de chez eux, au nom de leur sacro-sainte «sécurité nationale». «Guerre contre le terrorisme»: l’expression est lâchée par le président américain George W. Bush dès le 11 septembre au soir.
L’heure est à l’unanimité. Avec près de 3000 morts sur son sol, l’Amérique est frappée au cœur comme jamais depuis l’attaque de Pearl Harbor en 1941, et elle se doit de riposter. Cette année 2001 fait ainsi basculer le monde dans le nouveau millénaire. D’autant plus brutalement qu’elle clôt aussi une décennie, les années 1990, au cours de laquelle les États-Unis ont acquis le statut un peu trompeur d’hyperpuissance.
La chute de l’Union soviétique et la Guerre du Golfe, puis l’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce, ont instauré l’idée d’une suprématie idéologique et militaire des États-Unis. L’intellectuel américain Francis Fukuyama évoque alors même la «fin de l’Histoire» que viendrait sceller la victoire de la démocratie libérale.
Pour Andrew Bacevich, président du Quincy Institute for Responsible Statecraft, un cercle de réflexion qui prône la retenue en politique étrangère, cette «arrogance idéologique» et cette «conviction que les forces américaines étaient désormais invincibles» ont «conduit Bush et ceux qui l’entouraient à voir le 11-Septembre non seulement comme une gifle impardonnable, mais aussi comme l’occasion de démontrer, sans l’ombre d’un doute», la prétendue toute-puissance américaine.
«Va-t-en-guerre»
Entouré de néo-conservateurs interventionnistes et décidés à promouvoir le modèle démocratique à travers la planète – «va-t-en guerre», raillent leurs détracteurs –, le président républicain donne une définition très large de sa «guerre contre le terrorisme». «Ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous êtes avec les terroristes», résume «W». Il annonce «une longue campagne sans précédent» contre «tous les régimes qui soutiennent le terrorisme».
En janvier 2002, alors que les talibans ont été renversés et qu’Al-Qaïda a déjà considérablement souffert, il désigne un «axe du Mal» très éloigné de l’objectif initial, composé de l’Iran, de l’Irak et de la Corée du Nord.
Pensant jouir encore du capital de sympathie planétaire qui s’était manifesté au soir du 11-Septembre envers les États-Unis, le gouvernement Bush s’engage dans une marche périlleuse vers la guerre en Irak, en accusant à tort et sans preuves Saddam Hussein de cacher des armes de destruction massive. Mais il se trompe: «l’unanimité s’érode très rapidement» et «l’image de l’Amérique ne cesse de décliner» à mesure que «la guerre contre le terrorisme sort de son lit», souligne Elie Tenenbaum.
L’invasion de l’Irak, en 2003, va ainsi révolter une bonne partie de l’opinion internationale et «remettre en selle idéologiquement le jihadisme international qui était en fait assez affaibli après 2001», dit-il. Une nouvelle génération de jihadistes émerge, composée de jeunes gens de la région, mais aussi d’Occidentaux, qui viennent affronter les «forces d’occupation» après la chute de Saddam.
Une dizaine d’années plus tard, le départ des Américains laisse un vide qui favorise l’essor du groupe jihadiste État islamique (EI) et de son «califat» à cheval sur l’Irak et la Syrie. Washington est contraint de revenir, dès 2014, à la tête d’une coalition militaire internationale.
Image ternie
Le bilan de la guerre contre le terrorisme est donc pour le moins mitigé. Plus de 800’000 personnes sont mortes, avec un lourd tribut payé par les civils irakiens et afghans, pour un coût de plus de 6400 milliards de dollars pour les États-Unis, selon une étude publiée fin 2019 par la Brown University.
Il n’y a pas eu de nouvel 11-Septembre, mais des attentats spectaculaires de l’EI ont endeuillé l’Europe, comme en 2015 à Paris, et la menace terroriste persiste, bien que plus diffuse et décentralisée – il y a aujourd’hui deux à trois fois plus de jihadistes à travers le monde qu’en 2001, d’après une estimation citée par Elie Tenenbaum.
Les images du 11 septembre sont toujours sidérantes, glaçantes. On se souvient tous de ce que nous faisons… même 20 ans après #11septembre2001 # pic.twitter.com/BrBbcDfMky
— 284NAD (@284Nad) September 6, 2021
Quant à l’image des États-Unis, elle est ternie. Le recours à la torture, l’ouverture de la prison de Guantanamo pour priver les accusés des protections constitutionnelles américaines ou encore la banalisation des «éliminations ciblées» par drone en territoire étranger ont parfois placé la première puissance mondiale en marge de l’État de droit.
Le constat de Marsin Alshamary, spécialiste du Moyen-Orient basée à Bagdad, est amer: «La population de la région est jeune et ne connaît que cette Amérique» – elle n’a pas la mémoire du 11 septembre 2001. Pourtant, ajoute cette chercheuse invitée à la Harvard Kennedy School: «Le 11-Septembre a provoqué deux guerres qui auront changé à jamais l’équilibre des pouvoirs dans la région.»
L’affaiblissement de l’Irak a conséquemment renforcé «la puissance régionale de l’Iran», grand ennemi des États-Unis, «poussant l’Arabie saoudite à réagir dans une compétition aux effets désastreux», estime-t-elle, en évoquant notamment le conflit indirect que se livrent les deux pays au Yémen.
Ne jamais oublier.🕊️#11septembre2001 pic.twitter.com/bL0fjBz8s0
— Infos Séries (@SeriesUpdateFR) September 11, 2021
La Chine, «défi» du siècle
Aujourd’hui, un certain consensus se dégage: la guerre contre le terrorisme a été dévoyée de son objectif initial. Si les débuts ont permis de réduire la menace, les Occidentaux n’ont pas réussi «à gérer la phase de stabilisation des pays, provoquant une lassitude politique face à ces guerres», estime Elie Tenenbaum.
Même John Bolton, compagnon de route des néo-conservateurs sans en partager le dessein visant à exporter la démocratie par la force, déplore cette volonté de «bâtir des nations» à tout prix plutôt que de s’en tenir à de simples objectifs de lutte contre le terrorisme.
Surtout, martèle le président Biden pour justifier le retrait d’Afghanistan malgré la tournure des événements, l’Amérique doit réserver ses forces et ses ressources à la compétition contre ses «véritables concurrents stratégiques, la Chine et la Russie».
C’est d’ailleurs Pékin, et non plus le terrorisme, qui a été érigé par son gouvernement en «plus grand défi géopolitique du XXIe siècle», à l’unisson avec la grande majorité des dirigeants, diplomates et intellectuels américains.
«Nous dérivons actuellement vers une nouvelle Guerre froide avec la Chine», soupire Andrew Bacevich. «C’est vraiment un glissement vers un nouveau théâtre, dans lequel l’effort pour préserver ou rétablir la suprématie américaine va reprendre.»